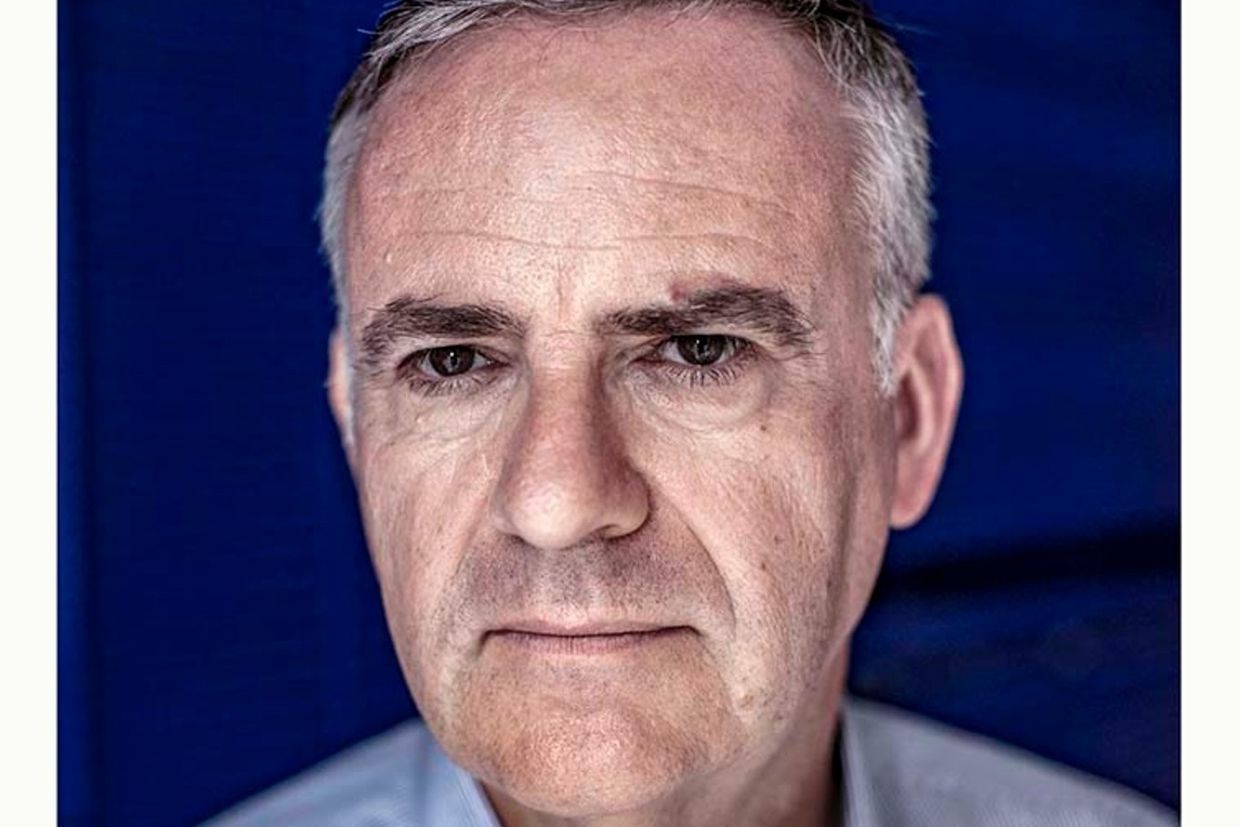Sous la pression, de nombreux salariés refusent aujourd’hui de prendre des fonctions d’encadrement. Un défi pour les entreprises, qui cherchent à renouveler les méthodes de travail de leurs managers, pour leur donner plus de sens.
Les cadres sont ressortis essorés de la crise. Et cela se ressent sur leur santé : 43 % des managers sont exposés aux risques psychosociaux, selon le 10e baromètre Empreinte humaine sorti en juillet dernier, soit 10 points de plus qu’en mars. « Ils ont subi les conséquences négatives du télétravail prolongé, avec l’intensification du travail, plus tôt ou plus tard », résume le psychologue Christophe Nguyen, fondateur de ce cabinet spécialisé.
Aujourd’hui, être cadre n’est plus une exception. Né avec la révolution industrielle et la machine à vapeur qui a créé l’usine, son directeur, ses ingénieurs et l’encadrement des ouvriers, le statut s’est banalisé. Au point que l’Insee a, pour la première fois en 2020, recensé plus de cadres que d’ouvriers. Parallèlement, la financiarisation de l’économie et la révolution numérique lui ont ôté de son lustre.
« L’arrivée des logiciels de reporting a donné l’impression que toutes les décisions pouvaient être prises d’en haut, les cadres se résumant à faire descendre l’information aux salariés et à reporter leur activité vers la direction, regrette Gérard Mardiné, secrétaire général du syndicat des cadres, la CFE-CGC. De plus en plus de cadres en souffrent, ne voulant plus être les maillons d’une chaîne. » Pour lui, au-delà du statut, « le cadre se définit d’abord par son autonomie ».
Une différence entre le statut de cadre et de manager
Or, les cadres se sentent de moins en moins autonomes. « Le Covid les a éloignés de leur direction, continue Christophe Nguyen. Ils se sentent englués dans des processus, peu soutenus et inquiets des projets d’évolution qui ne prennent pas en compte leurs difficultés. » Autant d’éléments qui couvaient depuis longtemps, mais que la crise sanitaire a révélés avec acuité. Selon Empreinte humaine, un tiers des managers regrette même d’être passés cadres, et 70 % des salariés ne veulent pas le devenir.
« Il faut néanmoins faire attention : cadre et manager ne sont pas tout à fait synonymes, met en garde Gilles Gateau, directeur général de l’Apec. Les managers en situation hiérarchique ne représentent qu’une moitié des cadres. Mais il y a aussi des experts, ingénieurs, juristes ou journalistes, qui en forment un petit tiers, et ceux qui encadrent des équipes de projet, sans lien hiérarchique. »
Certaines entreprises se sont donc attelées, parfois avant la crise sanitaire, à prendre soin de leurs cadres. « Depuis une quinzaine d’années, nous travaillons activement à faire évoluer le rôle du manager, à le valoriser et à motiver les vocations », indique Cécile Deman-Enel, responsable des nouvelles façons de travailler chez l’assureur Allianz France, qui a développé tout un éventail de formations, de la prise de poste aux ateliers managers, pour accompagner ceux-ci dans le nouveau modèle de travail. « Le manager n’est plus celui qui décide à la place des autres, mais celui qui aide à décider, celui qui donne les moyens de l’autonomie », précise-t-elle.
Favoriser le travail collaboratif
Chez OnePoint, où 480 « leaders » assurent les fonctions d’encadrement des 2 500 « associates », l’encadrement est plus fluide. « Pour les jeunes, la légitimité s’appuie moins sur la hiérarchie que sur l’expertise : c’est donc sur la base de communautés, qui sont autant de collectifs choisis, que nous avons bâti notre organisation », souligne Matthieu Fouquet, secrétaire général et cofondateur du cabinet de consulting, où, sur de grandes tables, chacun s’aide et se soutient dans un travail très collaboratif.
Parmi eux, Malik Ben Romdane. « L’idée ici est que chacun puisse s’épanouir dans un collectif », affirme cet ancien d’école de commerce devenu directeur de projet dans la communauté « tech ». « Sans ce modèle, je n’aurais jamais réussi à développer de nouvelles compétences. »

Illustration : Chez Gertrud
« J’appartiens à une génération charnière… et pas forcément exemplaire », résume Anne-Luce Peillon. « On nous a répété pendant nos études que nous étions l’élite de la nation, raconte cette polytechnicienne. Et on aurait pu commencer à changer les choses. Certes, on achète bio, mais quand nous avons commencé à travailler, la plupart d’entre nous n’avons pas vraiment choisi des boulots engagés. Même ceux qui ont créé leur start-up pour être indépendants n’ont pas remis en question les modèles de management ni cherché à s’investir dans l’écologie… »
Ce qu’elle fera pourtant à sa sortie de l’« X », en 2007, en s’investissant dans le développement durable au sein d’un grand groupe chimique français, avant de rejoindre en 2013 une entreprise publique de transport d’électricité où elle travaille à l’adaptation du réseau à la nouvelle donne énergétique. « Auparavant, les choses étaient relativement simples : il y avait 60 tranches nucléaires et 150 grands barrages ; aujourd’hui, il faut jongler avec des milliers d’éoliennes et des centaines de milliers de toitures avec des panneaux solaires », rappelle-t-elle. Un casse-tête pour ceux qui régulent les lignes électriques, veillant à éviter surtension et délestage, et pour lesquels elle développe des outils innovants.
Toutefois, Anne-Luce Peillon rejette les a priori sur la difficulté à faire bouger les grandes structures. « Même si les grandes entreprises peuvent parfois apparaître comme des paquebots, on peut les faire avancer, assure celle qui a aussi travaillé sur le projet de transformation de son entreprise. À force de s’accrocher, on peut convaincre. »
« Ce que je veux, c’est avoir un travail qui a du sens et un impact. »
Une conviction que cette maman de deux petits garçons a nourrie au MCC, où elle trouve régulièrement l’occasion de « se remettre en question sur plein de sujets », comme la manière de consommer, les relations avec les collègues, l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ou pour, justement, nourrir sa réflexion sur la transformation de son entreprise. « Une fois, il y avait quelque chose de tellement bien sur la subsidiarité que je l’ai copié-collé dans une diapositive pour une réunion sur l’organisation d’un projet le lendemain », dit-elle en souriant.
« Là où je suis, poursuit-elle, il y a des personnes de grande qualité, qui sont tout à fait conscientes de la nécessité de changer les choses. Beaucoup sont entrées dans l’entreprise par intérêt pour le service public et par souci de l’impact de leur travail sur la société. » Avec des approches différentes selon les générations, les trentenaires étant beaucoup plus animés par la volonté de s’investir dans la transition écologique.
Elle le voit dans l’équipe de projet qu’elle mène, même si elle n’a pas de responsabilité hiérarchique directe. « Ce que je veux, c’est avoir un travail qui a du sens et un impact », insiste-t-elle, avant d’expliquer, une étincelle dans les yeux : « Moi, ce qui m’intéresse, c’est de transformer les choses et d’emmener les gens vers ce qui va changer. Ce moment où le collectif comprend le problème, quand les idées émergent et que tout le monde s’y met, c’est vraiment génial ! »
« Je suis un ingénieur un peu hybride », sourit Pierre Vandenbroucke. Ce jeune cadre dans l’industrie automobile, où il travaille sur les véhicules connectés, a en effet eu un parcours atypique, passé à la fois par une école d’ingénieurs et une école de commerce. « J’aime beaucoup la technique, mais cette double formation m’a permis de ne pas oublier ce qu’il y a d’autre : le business comme l’humain », résume celui qui fut attiré très tôt par l’informatique mais s’attache désormais à faire le lien entre l’aspect technique et l’expérience des clients, notamment pour les véhicules connectés.
L’automobile est d’abord une passion pour ce jeune homme qui se rêve au volant d’une mythique berline des années 1960 mais qui, depuis la naissance de sa fille il y a un an, a senti poindre en lui une nouvelle conscience écologique. Un souci qui n’était certes pas complètement absent chez lui. « J’ai travaillé un temps dans une grande entreprise pétrolière et j’avais du mal à vivre certaines remarques de mon entourage. Mais les questions de transition écologique me touchent beaucoup plus depuis que je suis père. »
Le grand groupe automobile qu’il a rejoint en 2016 lui permet donc d’associer à la fois sa passion de toujours et sa volonté de faire évoluer la société sur ces sujets. « J’ai commencé ma carrière dans le consulting : c’est plus facile d’y lancer des projets. Mais la décision finale reste aux mains du client. Au contraire, dans un grand groupe, on peut participer aux changements à opérer. »
« Dans un grand groupe, on peut participer aux changements à opérer »
Quand l’occasion s’est présentée, et malgré son jeune âge, il s’est donc investi sans crainte dans les travaux sur la « raison d’être », qui résume à la fois les valeurs, la stratégie et les orientations sociale et environnementale de son entreprise. « Maintenant, il faut la décliner dans les différents secteurs, et je participe à un groupe de travail sur la manière dont on peut traduire cette raison d’être dans mon département », précise-t-il, certifiant que, même à son niveau, « on a vraiment la possibilité d’influer sur les choses ».
« La législation européenne a décidé la fin des moteurs thermiques en 2035 : cela nous oblige à être encore plus cohérents avec notre raison d’être sur la neutralité carbone », poursuit-il, s’estimant poussé dans ce sens par des dirigeants qui veillent également à ne pas fragiliser une entreprise considérée comme faisant presque partie du patrimoine français. « Je sens qu’ils ont réellement le souci des implications sociales de leurs décisions et qu’ils veulent aussi une mobilité durable accessible à tous », insiste-t-il.
Ce qui n’est pas forcément facile dans une période économique où l’ensemble du secteur de l’automobile est ballotté. « J’entends souvent en interne que, en cent vingt ans, nous avons survécu à toutes les crises : c’est vrai, même s’il faut quand même prendre en compte le contexte très difficile du moment. Mais agir dans une entreprise historique et qui veut garder ses racines en France, c’est quelque chose qui me fait lever le matin : il y a un patrimoine à entretenir mais aussi à transformer. » Un message qu’il adresse également aux jeunes diplômés qui hésitent à s’investir dans l’automobile : « L’enjeu, leur assure-t-il, est de transformer l’ancien monde. »
À l’époque, pourtant, après quinze ans de carrière en tant que juriste d’entreprise, il avait déjà eu quelques cas de conscience à gérer. Ainsi, quand le siège américain de sa société l’appelle un jour pour lui annoncer : « On a viré Untel, on te confie le dossier pour que tu trouves un motif de licenciement. »« J’étais assez choqué, j’ai eu beau expliquer que ça ne se passait pas comme cela en France, j’ai dû habiller de A à Z un dossier vide. Et on a gagné aux prud’hommes : j’étais révolté. Heureusement qu’on a perdu en appel ! »
Quelque temps plus tard vient le tour d’une commerciale jugée moins performante : « Depuis qu’elle a un enfant, elle n’a plus la niaque : il faut que tu la vires ! », lui lance la direction. « Ces deux dossiers m’ont secoué : toutes mes valeurs, toute ma vision du droit étaient bafouées. C’est d’ailleurs ce qui m’a amené au MCC où mes questions ont été le fil rouge de notre équipe pendant deux ou trois ans. »
« J’ai vu des choses atroces dans le monde de l’entreprise, mais aussi des gens prêts à se sacrifier pour leur équipe. »
Au fur et à mesure des rencontres, il apprend à passer d’une posture de protection déresponsabilisante – « ce n’est pas moi qui décide, je fais ce qu’on me demande » – à « un rôle d’acteur intégral ». « Peu à peu, je me suis autorisé une parole, à demander s’il n’y avait pas d’autres solutions. Pour ne pas que cela soit perçu comme un manque de loyauté, j’essayais de m’exprimer plus par questionnement que par affirmation. »
Surtout, il s’attache à humaniser les procédures ou, du moins, « à ne pas ajouter de l’inhumanité dans un moment déjà difficile ». « Rendre un licenciement le plus humain possible, cela a été long, reconnaît-il. Bien sûr, je ne peux pas dire au salarié que c’est injuste, mais je peux l’aider à se reconstruire au plus vite et à lui éviter des remises en cause inutiles. »
Quelques années plus tard, directeur juridique d’une filiale d’un grand groupe européen, il est donc mieux armé quand s’annonce un plan social. « Je me suis battu pour qu’on ne pense pas seulement à l’aspect économique et pour faciliter l’intégration de ceux qui rejoignaient la nouvelle structure », souligne-t-il. Toute son équipe retrouvera un emploi et il sera le dernier à être licencié, non sans payer le prix de ses efforts par un burn-out. « J’ai vu des choses atroces, mais aussi des gens prêts à se sacrifier pour leur équipe. Et tout cela est remonté quand j’ai regardé Un autre monde. »
Aujourd’hui avocat, il n’a plus de supérieur hiérarchique. « J’ai des clients, mais également une clause de conscience qui me permet d’en refuser. Et je le fais », assure celui qui s’attache aussi à prendre gratuitement les dossiers de certains salariés : « C’est ma conception du métier. »

Illustration : Chez Gertrud
Du plus loin qu’elle s’en souvienne, Hélène Roux a toujours été une passionnée de sciences. « Petite, on m’a offert des livres sur Pasteur et Marie Curie : j’ai été marquée par la façon dont la science pouvait agir sur les personnes, se rappelle la jeune femme. Mes amies aimaient appliquer ce qui existait, moi, je voulais innover. » D’où ses études de génétique. « La théorie m’intéressait beaucoup, mais la pratique, très répétitive, ne m’a pas plu », reconnaît-elle.
Elle s’interroge aussi sur les effets négatifs du progrès. « De la vache folle aux diabètes de plus en plus fréquents, des AVC à l’obésité, j’ai vu les conséquences de l’industrie agroalimentaire sur la santé », assure-t-elle, comprenant la révolte actuelle des étudiants des grandes écoles, comme AgroParisTech ou Polytechnique. « Pour ma part, j’ai choisi un axe de vie : ne pas nuire à l’humain. »
Elle s’oriente donc vers des études de santé publique durant lesquelles elle sera influencée par l’épidémiologiste Dominique Costagliola, connue aujourd’hui du grand public pour ses interventions parfois à contre-courant du gouvernement sur le Covid-19. « Son incroyable liberté d’esprit a transformé ma vie : elle m’a appris ce qu’était une démarche de recherche, qu’il était possible de critiquer l’existant dès lors qu’on a des arguments étayés. »
« Il y a des gens très intelligents, avec un très beau parcours dans les grandes écoles, mais qui sont complètement hors sol. »
Dans la même veine, Hélène Roux se passionne pour la vulgarisation scientifique, que ce soit auprès du grand public ou à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) puis à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) où, celle-ci étant utilisée comme interface entre les scientifiques et l’administration, l’incompréhension envers les soignants la choque. « J’ai emmené des informaticiens pour la première fois en réanimation, pour qu’ils voient comment travaillaient les infirmières, raconte-t-elle. Il y a des gens très intelligents, avec un très beau parcours dans les grandes écoles, mais qui sont complètement hors sol et ne savent pas ce que c’est que d’être médecin, d’être confronté à la douleur et à la mort. »
« Ce qui m’a frappée, c’est la non-considération des personnes, ajoute-t-elle. Dire à quelqu’un qui est épuisé par douze heures de garde que son activité baisse parce qu’il n’a pas coché les bonnes cases d’un logiciel, c’est d’une violence énorme. » Elle sera d’ailleurs contrainte de mettre son veto à des projets en développement depuis de longs mois. « Un logiciel qui prévoit des journées de huit heures tandis que les gardes font douze heures ou du matériel informatique qui n’est pas lavable alors qu’il va en réa : quand c’est dangereux pour les gens, il faut réagir », justifie-t-elle, aussi déterminée qu’elle peut paraître timide et réservée.
Après l’administration, Hélène Roux a rejoint le monde mutualiste et travaille désormais dans une fondation grâce à laquelle les plus grandes mutuelles financent des projets de recherche médicale qu’elle participe à sélectionner. « Mon travail est de faire le lien entre les mécènes et la recherche, de rendre celle-ci la plus réaliste possible pour le financeur, de lui expliquer les dernières tendances de la recherche, résume-t-elle. Bref, que tout le monde se comprenne au mieux. »
Une sœur à HEC comme elle, et une autre à Polytechnique. « Je suis un pur produit de l’excellence scolaire à la française », reconnaît sans peine Laurence Debroux, qui considère avoir longtemps eu un côté « trop bonne élève ». Elle se souvient ainsi d’une conférence où une jeune fille l’a interpellée avec virulence sur le développement durable : « Nous avons parlé. Elle a déversé sa colère sur moi, mais cela m’a fait beaucoup bouger : peut-être ma génération a-t-elle été trop bien élevée », résume celle qui, à la sortie d’HEC au début des années 1990, rejoint une banque d’affaires.
À cette époque du capitalisme financier triomphant, les fusions-acquisitions se succèdent. « Je trouvais très bête ce que je faisais au quotidien : je tombais de haut », se souvient-elle. Alors qu’elle travaille sur la privatisation d’Elf Aquitaine, un des patrons l’interpelle : « Mais que fais-tu dans la banque ? Viens dans l’industrie, tu seras bien plus heureuse ! » Elle gravira peu à peu les échelons de Sanofi-Aventis, découvrant aux côtés de son PDG, Jean-François Dehecq, une dimension plus humaine de la finance. « Il m’a appris que, quand on prend une décision, il y a 80 000 salariés derrière : j’allais travailler le matin en pensant à eux. »
« Il faut des activistes pour pousser sur le développement durable, mais on peut aussi changer les choses de l’intérieur. »
Après plus de quinze ans dans la pharmacie, elle ressent le besoin d’un poste plus opérationnel et rejoint JC Decaux, le spécialiste du mobilier urbain. Directrice financière, elle y est pendant un temps le seul membre du directoire à ne pas être de la famille. « J’ai découvert une grande liberté : à partir du moment où on s’entend sur les valeurs, on peut parler de tout. » Cinq ans plus tard, elle est « chassée » par le brasseur Heineken, contrôlé par la famille éponyme.
Présentée ensuite à la famille Agnelli, hier propriétaire de Fiat et aujourd’hui actionnaire minoritaire de Stellantis, elle siège depuis cinq ans au conseil de leur holding Exor et depuis un an à celui de la Juventus Turin. « Dans mes mandats, je suis payée pour être indépendante », en sourit celle qui s’attache à faire bouger les choses dans des environnements qui ont tendance à s’être éloignés des questions opérationnelles. « Dans les boards, on est souvent rivés aux chiffres d’hier, j’essaie d’attirer l’attention sur les questions d’aujourd’hui. »
Elle a ainsi découvert l’association La Fresque du climat (qui sensibilise aux enjeux du réchauffement climatique, NDLR) : « Depuis, j’y envoie tout le monde. » « Auparavant, ces questions relevaient surtout de la com’ dont on se préoccupait au moment du rapport annuel, souligne-t-elle. Ensuite les entreprises ont été interpellées sur la notion de risque. Mais aujourd’hui, c’est intégré dans les choix des consommateurs : les actionnaires savent le profit menacé et commencent à réellement tenir compte de ces questions dans la gouvernance. »
Des questions plus facilement abordées dans les entreprises familiales, assure-t-elle. « Quand vous avez votre nom sur la porte, vous faites attention aux générations futures », assure celle qui siège aussi au conseil du chimiste belge Solvay et de Novo Nordisk, un laboratoire pharmaceutique dont l’actionnaire majoritaire est une fondation danoise, « une autre forme de capitalisme patient ».
« J’ai trouvé mon bonheur et un sens à mon action dans ces entreprises capables d’avoir une vision et de s’y tenir, au-delà des résultats du trimestre qui vient : c’est un luxe énorme. » Elle en est convaincue : « Il faut des activistes pour pousser sur le développement durable, mais on peut aussi changer les choses de l’intérieur. »
Les jeunes cadres qui refusent désormais de devenir managers et d’encadrer une équipe ? « Je peux les comprendre, tout en les encourageant à prendre des responsabilités », reconnaît Tristan Lormeau, au terme d’une longue carrière de DRH dans l’industrie. « Mais il faut se demander pourquoi ce qui était accepté hier ne l’est plus aujourd’hui et pourquoi des jeunes ne font plus confiance à l’entreprise », souligne-t-il, constatant « une perte de plaisir », un « manque de reconnaissance ».
« Beaucoup pensent que l’entreprise ne les soutiendra pas demain », s’inquiète-t-il, invitant à « redonner de l’espace au terrain » et insistant sur quelques principes qui, au fil de sa carrière, ont forgé son management. La subsidiarité d’abord : « À force de procédures, le manager a l’impression de ne plus rien faire d’autre que du reporting : il faut donc lui redonner la possibilité de décider. » Tristan Lormeau plaide donc, par exemple, pour que les cadres disposent d’un budget pour l’animation de leur équipe : « À travers cette convivialité, vous pouvez aussi créer de la valeur : c’est dans l’informel et la gratuité que l’on crée le plus. »
La participation, ensuite : « Celui qui est au travail doit sentir qu’il peut transformer les choses et pas seulement les subir, souligne-t-il. Par exemple, quand on signe un accord entre partenaires sociaux, ce n’est pas pour nous mais pour l’ouvrier à l’atelier ou le technicien dans le bureau d’études : il faut donc rendre l’accord lisible par tous et se mettre à la place des personnes concernées pour que ce qu’on va signer soit reçu sur le terrain. »
« Il faut se demander pourquoi des jeunes ne font plus confiance à l’entreprise. »
Dernier point sur lequel il insiste : la solidarité. « Parmi les plus beaux moments que j’ai vécus comme DRH, il y a eu paradoxalement la crise de 2008-2009, raconte-t-il. Grâce à un accord avec les partenaires sociaux, on a réussi à faire en sorte que personne ne subisse de perte financière liée au chômage partiel, cadres et techniciens contribuant à la couverture chômage des ouvriers. Personne n’a perdu : cette solidarité effective a eu un impact profond sur l’entreprise. »
Subsidiarité, participation, solidarité : autant de principes puisés dans l’enseignement social de l’Église que ce chrétien engagé, nourri de spiritualité jésuite et qui a passé trente ans au MCC, s’est efforcé de confronter à la réalité de l’entreprise pendant des années. « La devise pédagogique des jésuites est ”Former des hommes pour les autres”, et je crois qu’être manager est justement une opportunité pour être au service des autres », développe-t-il.
Il ose même la comparaison avec le Bon Samaritain de l’Évangile, lui qui a su s’arrêter en chemin pour aider le blessé au bord de la route. « Il est celui qui détourne un moment les yeux de l’objectif de l’année pour s’intéresser aux problèmes de l’autre, relève Tristan Lormeau. Il est le type même du manager qui ne se limite pas à faire ce qu’on lui demande et qui prend du temps pour soutenir celui qui en a besoin. En plus, à la fin, il délègue à l’aubergiste et revient “checker” : c’est une très belle figure pour un cadre ! »
.
Écologie, éthique, gouvernance… Des managers en quête de sens